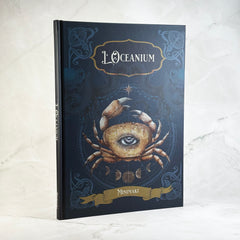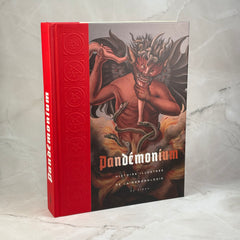|
AU SOMMAIRE...
1. Des savoirs médiévaux entre fois et sorcellerie |
Depuis les premiers siècles du Moyen Âge jusqu’aux fastes de la Renaissance, l’histoire de France s’est écrite autant dans la lumière des chroniques officielles que dans l’ombre des pratiques occultes. Derrière les rois, les guerres et les traités, se profilent devins, astrologues, alchimistes, sorcières et sociétés secrètes. Ces figures, marginales, ont pourtant influencé les décisions politiques et inspiré les peurs populaires. Loin d’être une curiosité folklorique ou un simple contrepoint à la religion, l’occultisme a tissé sa toile dans tous les recoins de la société française, du peuple jusqu’à la cour, jusqu'à faire de notre nation une place forte de cette science cachée. Histoire.
1. Des savoirs médiévaux entre foi et sorcellerie
À l’époque médiévale, la France voit coexister la foi chrétienne officielle et une multitude de pratiques occultes dans les traditions populaires. Bien avant que le terme occultisme n’existe (il n’apparaîtra qu’au 19ème siècle), les arts « occultes » – astrologie, magie, alchimie, divination – font partie du quotidien. Les paysans consultent des guérisseurs, utilisent talismans et incantations pour soigner ou jeter le mauvais œil, tandis que des sorcières (ou sorciers, ou mages) officient en secret dans les villages. Ces pratiques s’inscrivent dans le prolongement de traditions païennes anciennes (principalement celtiques et germaniques) qui se sont mêlées au christianisme au fil des siècles, entremêlées aux pratiques magiques orientales héritées de l’Antiquité.
Pour l’Église médiévale, ces pratiques populaires représentent un défi. Longtemps, les autorités religieuses tolèrent à moitié ces « sciences occultes » pratiquées en marge, surtout quand il s’agit d’astrologie ou d’alchimie perçues comme des savoirs issus de l’Antiquité. Mais à partir du 13ème siècle, le ton se durcit : l’Inquisition élargit sa chasse aux guérisseurs et sorciers, assimilant peu à peu leurs pratiques à l’hérésie. Un tournant décisif survient en 1326, lorsque le pape Jean XXII publie la bulle Super illius specula qui assimile explicitement les sorciers aux hérétiques. La sorcellerie devient dès lors un crime religieux : invoquer des esprits ou concocter des philtres magiques, c’est menacer l’ordre chrétien.
Dans ce contexte, des procès en sorcellerie apparaissent un peu partout. L’un des plus célèbres du Moyen Âge est celui de Jeanne d’Arc. En 1431, la Pucelle d’Orléans est jugée à Rouen pour « hérésie et sorcellerie » – des accusations largement politiques, les juges anglais cherchant à la discréditer en la peignant en sorcière inspirée par le Diable plutôt que par Dieu. On l’interroge même sur l’utilisation d’une prétendue Mandragore qu’elle aurait possédée. Jeanne nie farouchement toute pratique occulte et affirme que ses voix sont d’origine divine. Malgré son plaidoyer, elle est condamnée et brûlée vive comme relapse, c’est-à-dire retombée dans la sorcellerie et l’hérésie. Son supplice sur le bûcher, l’un des plus célèbres du Moyen Âge avec celui des Templiers un siècle plus tôt, illustre la peur qu’inspirait alors toute connexion supposée avec l’occulte. Aux yeux de ses ennemis, Jeanne incarne cette ambiguïté médiévale où un phénomène inexplicable – ses voix et ses victoires miraculeuses – pouvait relever soit du miracle divin, soit de la sorcellerie diabolique.

Jeanne d'Arc entrant dans Orléans
Les procès de sorcellerie se multiplient surtout à la fin du Moyen Âge et au début de l’époque moderne. Des manuels de démonologie circulent pour guider juges et inquisiteurs. En 1486 est publié le tristement célèbre Malleus Maleficarum (le « Marteau des sorcières »), un traité allemand qui influence toute l’Europe. La France n’est pas en reste : en 1580, le juriste français Jean Bodin publie De la démonomanie des sorciers, véritable somme sur la sorcellerie et les démons. Cet ouvrage, qui définit la sorcière comme « quiconque, par des moyens diaboliques, cherche sciemment à accomplir quelque chose », devient une référence pour la répression judiciaire des adeptes de la magie noire. Bodin y affirme la réalité des sabbats, des pactes sataniques et préconise une sévérité implacable contre les sorciers, y compris la torture et le bûcher. Ses idées auront un impact immense sur les chasses aux sorcières en France, légitimant aux yeux des tribunaux la traque du mal occulte.
Ainsi, du bûcher des Templiers au supplice de Jeanne d’Arc, des guérisseuses de village aux démonologues de la Renaissance, le Moyen Âge français est loin d’être une ère de naïve crédulité ou d’ignorance totale. Bien au contraire, l’occulte y est omniprésent. Il fascine autant qu’il effraie. D’un côté, le peuple continue de recourir à des pratiques magiques ancestrales pour conjurer le sort ou guérir les maux du quotidien. De l’autre, l’élite ecclésiastique développe une véritable démonologie érudite pour combattre ce qu’elle perçoit comme une menace infernale. Ce jeu d’attraction-répulsion envers l’occultisme marquera durablement la société française – et il est loin de se limiter au petit peuple.
2. Astrologues et alchimistes auprès des rois
Fait méconnu mais révélateur : l’attrait pour l’occultisme ne se cantonne pas aux chaumières paysannes – il s’étend jusqu’aux châteaux des rois de France. Nombre de souverains et de grands du royaume ont eu recours aux astrologues, devins ou alchimistes pour guider leurs décisions, depuis le Haut Moyen Âge jusqu’à l’époque moderne. Des rois pourtant très chrétiens, comme Louis VII au 12ème siècle ou Louis IX (Saint Louis) au 13ème, n’hésitèrent pas à consulter les astres autant que leurs confesseurs. Cette présence de l’occultisme au sommet de l’État s’accroît encore à la fin du Moyen Âge : le roi Charles V le Sage (1338-1380) s’entoure d’astrologues et fait traduire de nombreux traités d’astrologie et d’alchimie pour sa bibliothèque royale. Il crée même à Paris un collège d’astrologie. Quelques décennies plus tard, son petit-fils Charles VIII a pour astrologue attitré un certain Simon de Phares, qui laissera une chronique manuscrite des plus fameux astrologues de son temps.
C’est à la Renaissance cependant que l’ésotérisme pénètre véritablement les cercles du pouvoir. L’invention de l’imprimerie (vers 1450) va ouvrir à l’élite cultivée de nouvelles perspectives : les textes hermétiques de l’Antiquité réapparaissent, les traités d’alchimie, de cabale et d’astrologie circulent sous le manteau. La Renaissance nourrit en effet un goût prononcé pour l’occulte : les penseurs de l’époque cherchent à réconcilier le savoir antique, la magie et la foi chrétienne. En Italie, Marsile Ficin et Pic de la Mirandole étudient la magie céleste et la cabale pour atteindre une forme de vérité divine. Cette tendance gagne la France : les cours royales deviennent le théâtre d’expériences ésotériques. On y échange des almanachs astrologiques et des grimoires, on débat des propriétés mystérieuses de la nature. L’alchimie et la transmutation des métaux en or et l’élixir d’immortalité ; l’astrologie pour prédire l’issue des guerres ou la santé des princes ; la magie – blanche ou noire – pour les enjeux du quotidien.

Catherine de Médicis
La figure emblématique de cette alliance entre le pouvoir et l’occulte est sans doute Catherine de Médicis (1519-1589). Reine de France au 16ème siècle, Catherine est passionnée d’astrologie et de magie. Elle s’entoure de devins et astrologues, dont le florentin Cosme Ruggieri, son confident, et le Provençal Michel de Nostredame, dit Nostradamus. Nostradamus, médecin de formation, devient l’astrologue attitré de la cour des Valois : il établit les horoscopes du roi Charles IX et publie dès 1555 ses fameuses Prophéties, une collection de quatrains énigmatiques pour prédire l’avenir du monde. Ces vers obscurs rencontrent un immense succès populaire – ils seront réimprimés pendant des siècles – et font de Nostradamus l’astrologue le plus célèbre de l’histoire de France. Catherine de Médicis, quant à elle, consultait ses astrologues pour les affaires de l’État comme pour son destin familial. La légende l’entoure d’une aura inquiétante : reine italienne adepte des poisons et des sciences occultes, murmurait-on, elle tirerait les ficelles dans l’ombre pour protéger le trône de ses fils. Si son image de « reine empoisonneuse » relève en partie de la propagande hostile, il est avéré que Catherine faisait venir à sa cour des mages, qu’elle expérimentait des remèdes alchimiques et s’intéressait aux arts divinatoires. Un épisode célèbre raconte qu’elle fit construire un observatoire privé à Paris pour Cosme Ruggieri, et qu’ensemble ils pratiquaient des séances occultes pour connaître l’avenir de la dynastie. On prétend même que l’astrologue Ruggieri aurait organisé des rituels d’envoûtement par dagyde – une pratique consistant à nuire à un ennemi en torturant une figurine à son effigie – visant des adversaires politiques, et qu’il ne dut son salut qu’à la protection de Catherine lorsque ces faits faillirent éclater au grand jour. L’opinion publique de l’époque était convaincue que la mort prématurée du jeune Charles IX (d’une mystérieuse tuberculose hémorragique) résultait d’un maléfice lié à ces sombres manipulations.
 Rituel entre Cosme Ruggieri et Catherine de Médicis. Source
Rituel entre Cosme Ruggieri et Catherine de Médicis. Source
Parmi les figures qui alimentent les mythes ésotériques de la Renaissance, il faut citer aussi Nicolas Flamel. Ce bourgeois parisien du 14ème siècle (mort en 1418) a laissé le souvenir d’un philanthrope ayant fait bâtir des hôpitaux… mais la rumeur en a fait bien plus que cela. Peu après sa mort, on colporte que Flamel aurait découvert le secret de la pierre philosophale, la substance alchimique légendaire capable de changer le plomb en or et de donner la vie éternelle. Sa fortune inexpliquée, qu’il avait consacrée à des œuvres pieuses, sert de point de départ à ce mythe. Au fil des siècles, Nicolas Flamel devient le héros incontournable des récits d’alchimie : des traités ésotériques lui sont attribués (apocryphes, publiés bien après sa mort), des romans et plus tard des films le mettent en scène en immortel détenteur du grand secret. Au 16ème siècle, de nombreux savants et aventuriers se lancent dans la quête de la pierre philosophale, parfois avec le soutien discret de grands personnages. Le roi Henri II lui-même aurait financé des ateliers d’alchimistes, espérant remplir les coffres du royaume grâce à la fabrication d’or.
Dans les hautes sphères de la société française, la frontière entre sciences reconnues et sciences occultes reste longtemps poreuse. Au début du 17ème siècle, un astronome aussi sérieux que Johannes Kepler (à l’origine des lois sur le mouvement des planètes) peut encore pratiquer l’astrologie sans entacher sa réputation. Pour les érudits de la Renaissance, explorer les forces cachées de la nature fait partie intégrante de la compréhension du monde. Ce n’est qu’à la toute fin du 16ème siècle et surtout au 17ème que le fossé va se creuser entre la science officielle et l’ésotérisme. Le développement de la méthode scientifique, basée sur l’observation et la raison, conduit une nouvelle génération de savants à rejeter les vieux corpus occultes, jugés trop entachés de superstition. En France, l’établissement de l’Observatoire de Paris en 1672 symbolise ce tournant : les astronomes qui y travaillent reçoivent formellement interdiction de dresser des horoscopes, l’astrologie étant désormais bannie du domaine scientifique dit sérieux. Désormais, l’astronomie regarde les étoiles, mais ne prétend plus lire le destin dans leur course.
3. L’ombre de l’occulte sur l’époque moderne
Malgré la progression des idées rationalistes, l’attrait pour l’occulte reste puissant dans la société française du 17ème siècle. Simplement, il se fait plus clandestin. Au grand jour, l’on affiche un esprit cartésien et l’on moque la crédulité des générations passées. Mais dans le secret des boudoirs, on continue de consulter des devineresses, de fabriquer des philtres et d’invoquer les esprits. Vers la fin du règne de Louis XIV, cette face cachée de la cour éclate au grand jour dans ce qu’on appellera l’Affaire des Poisons. Ce scandale, qui éclabousse la noblesse française dans les années 1679-1682, révèle l’ampleur insoupçonnée d’un réseau occulte au cœur même de la capitale. Une enquête ordonnée par le roi montre que « des nobles, des bourgeois prospères et le peuple commun recouraient secrètement à des devineresses, alors fort nombreuses à Paris, pour obtenir des drogues et poisons, pour des messes noires et d’autres desseins criminels ». Autrement dit, tous les milieux sociaux – de la courtisane à l’artisan – font appel aux services de sorcières et d’empoisonneuses.

Catherine Deshayes, ou La Voisin. Source
Le personnage central de cette ténébreuse affaire est Catherine Deshayes, dite La Voisin, une tireuse de cartes et fournisseuse de poisons qui aurait vendu ses services à des centaines de clients. Dans son sillage gravitent des mages noirs, des prêtres défroqués célébrant de sombres messes et un réseau d’apothicaires véreux. Les révélations font frémir la cour : parmi les personnes compromises figure la marquise de Montespan, favorite de Louis XIV en personne. D’après les témoignages arrachés aux comparses de La Voisin, Madame de Montespan aurait, durant des années, eu recours à la magie – filtres d’amour et messes noires – pour conserver l’affection du Roi Soleil et écarter ses rivales. Elle aurait même commandité l’empoisonnement d’une jeune rivale trop en vue, Mlle de Fontanges, et envisagé de droguer le roi lui-même lorsque son amour faiblissait. Bien que ces accusations n’aient pu être formellement prouvées (Louis XIV, effrayé du scandale, fera cesser les poursuites publiques dès que Montespan sera mise en cause), l’affaire révèle aux yeux de tous la présence réelle de l’occulte au cœur du pouvoir, comme un étonnement mais aussi comme une validation que oui, l'occulte existe. Dans les salons dorés de Versailles, on pratiquait donc aussi la sorcellerie – mais une sorcellerie vénale et criminelle, faite de poisons distillés dans l’ombre. Au total, la Chambre ardente (le tribunal d’exception créé pour l’occasion) tient 210 séances et prononce 36 condamnations à mort. La Voisin elle-même est brûlée en place de Grève (actuel parvis de l'hôtel de ville) en 1680, emportant avec elle bien des secrets. Nombre de grands noms cités durant l’enquête (y compris la Montespan) s’en sortent par des exils ou une réclusion discrète, le roi ayant préféré éviter un éclatement public de l’affaire d’État qu’elle représentait. Il n’en demeure pas moins que la plus flamboyante cour d’Europe abritait en son sein un véritable monde souterrain de magie, de sacrifices et de pactes.
Au-delà de ce retentissant scandale, l’époque moderne voit la persistance diffuse des pratiques occultes. Dans les campagnes de l’Ancien Régime, on craint toujours les sorciers et les ensorceleuses. Des chasses aux sorcières sporadiques ont lieu dans certaines régions de France – par exemple au Pays basque en 1609, où sous commission du roi Henri IV le juge Pierre de Lancre mène une répression féroce et envoie au bûcher des dizaines de personnes accusées de sabbat et de magie noire. De même, en Franche-Comté ou en Lorraine, des procès en sorcellerie apparaissent jusque vers 1650. Mais peu à peu, le scepticisme des Lumières gagne du terrain, et ces persécutions reculent.
Dans les cercles intellectuels des 17ème–18ème siècles, l’heure est davantage à l’expérimentation scientifique. Certaines pratiques occultes se transforment et renaissent sous une apparence plus « rationnelle ». Un personnage comme le médecin autrichien Franz-Anton Mesmer, qui triomphe à Paris dans les années 1780 grâce au magnétisme animal : un fluide invisible qu’il canalise en de mystérieuses séances collectives. Si Mesmer rejette l’étiquette de mage, beaucoup voient en lui un guérisseur occultiste, héritier des magnétiseurs et astrologues d’antan. D’autres aventuriers ésotériques parcourent l’Europe en fascinant les élites : le comte Alessandro Cagliostro, grand maître d’une Égyptomanie mystique, séduit les nobles parisiens avec ses élixirs et ses rituels avant d’être impliqué dans l’Affaire du collier de la reine. À la veille de la Révolution, l’esprit rationaliste côtoie ainsi une vive curiosité pour l’irrationnel. Il n’est pas anodin que de nombreuses loges maçonniques – apparues en France vers 1725 – cultivent un goût pour l’ésotérisme, multipliant les symboles alchimiques et les références templières dans leurs rites. De même, dès la fin du 17ème siècle circulent en Europe des manifestes mystérieux attribués aux Rose-Croix, une fraternité secrète adepte de sagesse occulte. Paris elle-même, en 1623, se réveilla placardée d’étranges affiches annonçant l’arrivée de ces Rose-Croix invisibles “maîtres de la toute-puissance” – de quoi alimenter toutes les légendes. Même quand la science officielle s’en détourne, une partie des élites continue de chercher dans le secret des loges la connaissance cachée des anciens mages.
4. Le renouveau occultiste au 19ème siècle
Après la tourmente révolutionnaire et l’Empire, la France du 19ème siècle connaît un étonnant retour de flamme de l’occultisme. À l’âge du positivisme triomphant et de l’industrialisation, nombre d’esprits aspirent à des mystères plus profonds que ceux qu’offre la science matérialiste. C’est dans ce contexte que naît ce qu’on appellera plus tard “l’occultisme” comme mouvement de pensée à part entière. « L’occultisme comme courant de pensée est né sur les ruines des guerres révolutionnaires et impériales. Il a fait entendre sa voix en contre-chant de celle de la Restauration dans le premier tiers du 19ème siècle » analyse l’historien Jean-Pierre Laurant. En effet, dès les années 1830-1850, Paris redevient un haut lieu de l’ésotérisme : des salons littéraires s’enthousiasment pour le magnétisme, les sciences occultes sont réévaluées à la lumière du romantisme, et l’on tente de fonder une « épistémologie nouvelle » fusionnant mysticisme et science.
 Éliphas Lévi
Éliphas Lévi
C’est à cette époque que le mot « occultisme » lui-même fait son apparition en français (vers 1842). Un ancien séminariste nommé Alphonse-Louis Constant – plus connu sous le pseudonyme d’Éliphas Lévi – publie en 1856 Dogme et Rituel de la Haute Magie, un ouvrage fondateur qui pose les bases de l’occultisme moderne en synthétisant cabale, tarot, alchimie et magnétisme. Éliphas Lévi se proclame héritier de Paracelse et de Swedenborg, et prétend réconcilier la foi et la science par la magie. Son succès est retentissant à travers l’Europe. Bientôt, des cercles occultistes structurés se forment : en 1888, le Dr Gérard Encausse, dit Papus, fonde à Paris l’Ordre Martiniste et une École Hermétique. Il définit l’occultisme comme « l’ensemble des théories, des pratiques et des voies de réalisation dérivées de la Science occulte ». Sous sa plume et celle de ses contemporains (Stanislas de Guaïta, Joséphin Péladan,...), l’occultisme français de la Belle Époque revendique son ancrage dans un christianisme ésotérique, se présentant comme un complément à la religion plutôt que son ennemi.
Parallèlement, des influences étrangères viennent nourrir ce renouveau. La Société Théosophique, fondée en 1875 par Helena Blavatsky, introduit en France les idées ésotériques venues d’Orient. Blavatsky, personnage haut en couleur, popularise la notion d’une tradition occulte universelle mêlant bouddhisme, hindouisme, kabbale et spiritisme. Ses ouvrages rencontrent un public considérable et posent les bases de courants ésotériques du 20ème siècle, jusqu’au New Age actuel. On assiste aussi à l’essor du spiritisme par Allan Kardec : communiquer avec les esprits par le biais de tables tournantes devient une mode impériale (Napoléon III lui-même aurait assisté à des séances). Tout ceci témoigne d’une soif persistante pour le mystère dans la société française, du plus humble au plus puissant.
Le 19ème siècle referme ainsi la boucle de cette longue histoire : l’occultisme, jamais éradiqué, refait surface au grand jour, cette fois sous forme de mouvements structurés, de revues, de loges et d’ordres initiatiques. Ce qui était autrefois clandestin ou réservé aux cours royales s’affiche désormais dans les librairies et les salons parisiens. En 1900, Paris est à la fois la capitale des sciences rationnelles et celle des sciences occultes, hébergeant congrès de psychologie et conférences de magie cabalistique.
Ainsi, l’histoire de France est liée à l’occultisme, intimement et indissociablement, non pour glorifier l’irrationnel, mais pour rappeler que le désir de percer les secrets de la nature et du destin est universel et intemporel. Ce fil occulte, tissé à travers les siècles, fait partie du patrimoine immatériel de la nation – une part d’ombre souvent cachée, mais jamais éteinte, qui continue d’alimenter la curiosité et l’imaginaire.
Sources :
-
Paul Lacroix, Sciences et lettres au Moyen Âge et à la Renaissance
-
Procès de Jeanne d’Arc (transcriptions historiques, notamment la version publiée par Jules Quicherat)
-
Jean Bodin, De la démonomanie des sorciers (1580)
-
Clavicule de Salomon (grimoire médiéval traduit par S.L. Mathers)
-
Simon de Phares, Recueil des plus célèbres astrologues et devins
-
Pierre de Lancre, Tableau de l’inconstance des mauvais anges et démons (1612)
-
Robert Mandrou, Magistrats et sorciers en France au XVIIe siècle
-
Archives de l’Affaire des Poisons (1679–1682), Chambre ardente
-
Michel de Nostredame (Nostradamus), Les Prophéties (1555)
-
Jean-Pierre Laurant, L’ésotérisme contemporain et ses lectures de la tradition
-
Éliphas Lévi, Dogme et rituel de la haute magie (1856)
-
Papus (Gérard Encausse), Traité élémentaire de science occulte
-
Dictionnaire critique de l’ésotérisme, dir. Jean Servier (PUF)