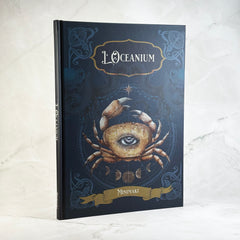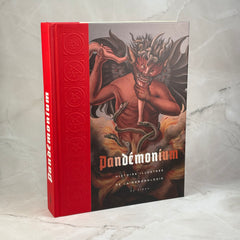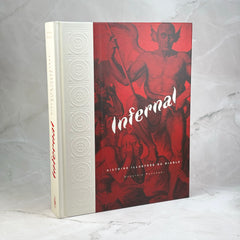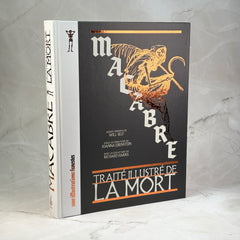Imaginez un village d’Alsace au 19ème siècle. Une vache dépérit, le lait tourne et la fermière suspecte un maléfice. Plutôt que de s’en remettre au seul médecin, on fait appel au braucheur du coin – ce guérisseur qui récite des prières et connaît les gestes pour conjurer le mauvais sort. À la lueur d’une chandelle, il récite une incantation en dialecte germanique tout en traçant un signe de croix sur l’animal. Non loin de là, dans la chambre du fils parti au service militaire, on a glissé dans son sac un curieux parchemin couvert de textes : une lettre du Ciel, pour le protéger de la balle et du danger. Ces scènes illustrent l’esprit des pratiques magico-religieuses qui ont perduré en Alsace et dans les contrées germanophones de Lorraine. Entre Braucherei (rituels de bénédiction et de guérison) et Hexerei (sorcellerie malveillante), s’est développé tout un univers de rites populaires enracinés dans la foi chrétienne locale. Découverte d'une magie des campagnes très locale.
Une tradition dans la foi et dans le quotidien
Au cœur de ces pratiques se trouve une vision du monde où le sacré et le profane s’entremêlent. L’Alsace et la Lorraine germanophone, terres de forte religiosité, ont vu fleurir une magie populaire chrétienne héritée du Moyen Âge et renouvelée par les courants occultes de la Réforme. Dans ces communautés rurales, on perçoit la création entière – famille, bétail, champs, maison – comme reliée à un ordre cosmique chrétien. La religion n’est pas qu’au temple le dimanche : elle imprègne chaque geste du quotidien. On prie pour la santé des enfants, la protection de la ferme, la fécondité des récoltes. On bénit la maison aux grandes fêtes, on place des croix de bois aux frontières du village pour le préserver. Bref, la spiritualité est vécue dans chaque acte de la vie domestique et agricole, par une multitude de brauches (rites) qui donnent du sens aux joies comme aux épreuves de l’existence.
Cette magie traditionnelle puise ses sources dans la foi chrétienne tout en conservant des racines plus anciennes. De nombreux rituels étaient en effet d’antiques formules païennes adaptées en prières de saints, transmises oralement de génération en génération. À force de transmission, les mots originaux se sont altérés : certaines incantations sont devenues quasiment inintelligibles, un jargon sacré que l’on ne comprend plus mot à mot – sans que cela nuise à leur prestige ni à leur efficacité perçue. L’important est ailleurs : c’est l’intention, la foi profonde du guérisseur et du consultant, qui active le pouvoir du rite. Dans l’esprit local, Dieu et les forces invisibles forment un tout ; utiliser une prière spéciale ou un geste rituel pour soigner n’est pas vu comme de la superstition opposée à la religion, mais au contraire comme un prolongement naturel de la Providence. Cette intégration du sacré dans la vie courante était telle que même les transformations religieuses (Réforme protestante, montée de la science,…) n’ont pas éradiqué ces pratiques, qui ont subsisté en les adaptant au nouveau contexte. Les saints autrefois priés officiellement continuent d’être invoqués à la maison pour des besoins précis (guérison, protection du bétail,...), y compris chez les protestants qui, officiellement, ne les honorent plus. Autrement dit, le peuple a gardé son « petit rituel » secret, parallèlement aux offices dominicaux.
Un autre trait marquant de cette tradition est son mode de transmission ésotérique. Le savoir du Braucher (praticien de la Braucherei) se passe généralement de manière informelle, au sein de la famille ou de la communauté proche. Fait intrigant, on retrouve fréquemment la règle d’alternance : un homme ne peut apprendre ces secrets que d’une femme, et une femme d’un homme. Ainsi, la grand-mère enseignera à son petit-fils, le grand-père à sa petite-fille. Cette règle de transmission croisée assure un équilibre et, de fait, confère aux femmes comme aux hommes une place égale dans le rôle de guérisseur traditionnel. Chacun, quel que soit son sexe, peut être détenteur du « secret » – pourvu qu’il le reçoive avec sérieux et dans l’intention sincère d’aider autrui. Car on n’apprend pas la Braucherei pour la gloire ou la curiosité intellectuelle : on l’apprend « pour de vrai », dans le but de s’en servir humblement au service de la communauté. Le don est considéré comme sacré et son abus moralement dangereux. De ce fait, le savoir est jalousement préservé : beaucoup de praticiens ont préféré emporter certains secrets dans la tombe plutôt que de les divulguer à quelqu’un d’indigne ou à un simple curieux. Cette discrétion fait que la tradition a survécu longtemps sous le radar des autorités religieuses ou médicales. Et lorsque le lignage de transmission se brise faute de disciple approprié, il faut parfois qu’un étranger ou un apprenti d’un autre village vienne recueillir l’héritage pour qu’il ne se perde pas.
Enfin, il faut comprendre que ces pratiques magiques alsaciennes et lorraines sont foncièrement chrétiennes dans leur symbolisme. On y prie le Dieu trinitaire, on y invoque le Christ, la Vierge Marie, les archanges et les saints. On utilise des objets bénits (rameaux des Rameaux, eau bénite, médailles religieuses) et des textes sacrés (versets bibliques, Pater Noster, Ave Maria). Bien que l’Église institutionnelle ait parfois condamné ces « superstitions », dans l’esprit du village on ne sert pas le Diable en agissant ainsi : au contraire, on canalise la puissance divine pour se défendre du Mal. C’est pourquoi on parlait volontiers de “bonne magie” à propos de la Braucherei, par opposition à la “mauvaise magie” satanique attribuée aux sorcières (Hexen). On parle donc de la Braucherei bienfaisante du guérisseur, et d’autre part de la Hexerei malfaisante du sorcier, sans oublier un élément clé de ce patrimoine magique : le Himmelsbrief, la fameuse lettre céleste protectrice.
La Braucherei, ou comment guérir et protéger par le sacré
Le terme dialectal Braucherei désigne l’ensemble des rituels de guérison et de bénédiction pratiqués traditionnellement dans ces régions. En Pennsylvanie, où de nombreux Alsaciens et Lorrains ont émigré au 18ème siècle, on a traduit Braucherei par powwow, terme aujourd’hui couramment utilisé pour ce système de médecine chrétienne. Mais bien avant son exportation outre-Atlantique, la Braucherei fleurissait dans nos campagnes sous des noms variés : on parlait en français de guérisseurs, de faiseurs de secrets, de désenvoûteurs ou plus poétiquement de leveurs de sorts. Le rôle du Braucher (le praticien de la Braucherei) était multiple : soigner les maux du corps et de l’âme, protéger les hommes, les bêtes et les récoltes, attirer la chance et le succès dans les activités quotidiennes. C’était un guérisseur-ensorceleur blanc (comprendre par son intention bienveillante), faisant le bien par des moyens occultes mais sanctifiés.
Les méthodes de la Braucherei combinent toujours des éléments spirituels et matériels. La prière est au cœur du rituel : une oraison particulière, transmise par mémoire, qui invoque Dieu ou tel saint pour l’affliction concernée. Mais à cette prière s’ajoutent des gestes et supports – car toute la création peut servir de canal au divin. Un exemple courant est celui du geste de la croix tracé trois fois au-dessus de la zone malade, parfois accompagné d’un souffle ou crachat léger (symbole d’expulsion du mal). On utilise aussi des objets : un morceau de pain bénit, de l’huile de la Chandeleur pour oindre une plaie, une ceinture de la Vierge portée par une parturiente pour faciliter l’accouchement. Les plantes médicinales tiennent également une place importante, puisque beaucoup de brauchers connaissaient l’herbalisme et associaient remèdes naturels et prières. Cette alliance de la phytothérapie et du spirituel est typique : on traite le mal sur tous les plans à la fois, physique et invisible.
Ce qui frappe dans la Braucherei, c’est l’attention aux “signatures” et correspondances. Chaque mal a son remède idoine, déterminé par analogie ou par tradition sacrée. Pour soigner une brûlure, on invoquera saint Laurent (supplicié sur un gril ardent) ou la Vierge Marie au titre de Notre-Dame du Feu, et l’on récitera une prière de “refroidissement” en passant un linge humide – le mal de feu se trouvant ainsi symboliquement transféré dans l’eau. De même, contre le feu de Saint-Antoine (érgotisme ou zona), on pouvait réciter l’Évangile de saint Antoine ou appliquer une huile consacrée le jour de sa fête. Les prières de Braucherei ont la particularité d'être très belles, imprégnées de poésie : on y parle aux éléments, on conjure la maladie comme une entité à qui on ordonne de s’en aller. Telle prière de bénédiction commence par : « Aujourd’hui je me lève et je m’en vais au nom de Dieu le Père †, Dieu le Fils †, Dieu le Saint-Esprit †… Que Jésus, Marie, Joseph, les Trois Saints Rois m’accompagnent sur le chemin et protègent ma maison et les miens… ». On le voit, le langage de ces rituels est pétri de références chrétiennes (Trinité, Saints, Rois mages) tout en se déroulant en-dehors du cadre liturgique officiel. C’est une liturgie officieuse de la vie quotidienne, transmise par la grand-mère plutôt que par le prêtre.

Carré Sator, talisman de protection. Source
Les Braucher agissent de manière empirique et humble. Ils ne se proclament pas thaumaturges aux grands pouvoirs, mais plutôt instruments de Dieu. Le succès de leurs interventions repose sur la foi : foi du guérisseur, foi du patient. On raconte que certaines formules ne “prennent” que si le consultant croit fermement en Dieu – condition sine qua non énoncée parfois dans le texte même du charme. Une formule alsacienne pour arrêter les hémorragies débute par « Arrête-toi sang, comme Jésus-Christ s’est arrêté dans le Jardin des Oliviers », faisant clairement allusion à la Passion du Christ pour conférer son efficacité. Ainsi, la Braucherei se présente comme une extension de la prière, une prière plus incarnée, utilisant le verbe et le geste pour solliciter une aide divine immédiate.
Les pratiques de Braucherei couvrent un large éventail, allant des soins de santé aux bénédictions préventives :
-
Transférer la maladie dans un arbre : pour guérir un mal chronique (fièvre persistante, “pauvreté” du sang, épuisement), un guérisseur pouvait effectuer un rituel de transfert vers un arbre. Le procédé était précis : il recueillait d’abord une partie symbolique du mal du patient (par exemple des rognures d’ongles, ou quelques gouttes de sang) qu’il plaçait dans un objet creux – une petite plume de plume d’oie taillée en tube. Puis, un vendredi avant l’aube, lors de la lune décroissante, il allait percer un trou dans un arbre sauvage (un chêne ou un poirier stérile) du côté où le soleil se lève, y insérait la plume contenant la maladie, et rebouchait l’ouverture avec un coin de bois en frappant trois coups. La symbolique est forte : le vendredi (jour de la Passion du Christ) et la lune nouvelle déclinante devaient entraîner le mal “vers le bas et vers l’intérieur” – en l’occurrence, dans l’arbre qui servirait de réceptacle. Ainsi libéré, le patient récupérait sa vigueur pendant que l’arbre, lui, était supposé flétrir ou se dessécher petit à petit en emportant le mal. Cette pratique de “plugging” (boucher l’arbre après y avoir enfermé le mal) était encore attestée jusqu’au 19ème siècle dans la région rhénane et aux États-Unis chez les descendants de ces immigrants.
-
Diagnostic d’ensorcellement : bien sûr, le Braucher était consulté pour déterminer si un mal mystérieux avait une cause naturelle ou occulte. L’un des procédés de diagnostic magique consistait à examiner la réaction de l’urine du malade sur des braises ardentes. Un guérisseur lorrain du 17ème siècle explique : « Je faisais chauffer l’urine sur un tison rouge : si elle rougit et s’évapore, c’est un mal naturel ; mais si elle blanchit et ne se consume pas, c’est qu’il y a un sort ». Dans le cas où le test révélait un sortilège, le guérisseur savait qu’il devait employer des remèdes spirituels supplémentaires – prières de délivrance, fumigations de soufre bénit, ou contre-sort – en plus des remèdes médicaux classiques.
-
Protection du foyer et du bétail : la Braucherei comprenait toute une panoplie d’actions préventives pour mettre maison et ferme à l’abri du mal. On fixait, par exemple, sur la porte de l’étable un symbole sacré – telle la monogramme C✝M✝B (initiales des Trois Mages Caspar, Melchior, Balthasar) accompagné d’une bénédiction – pour empêcher les sorcières de “voler” le lait des vaches. De même, on clouait parfois un fer à cheval au-dessus du seuil (symbole de chance et apotropaïque) ou on traçait avec de la craie bénite, à l’Épiphanie, une croix sur chaque porte. Certaines de ces coutumes perdurent aujourd’hui transformées en tradition religieuse : par exemple l’inscription du C✝M✝B sur les portes après l’Épiphanie est encore pratiquée dans les villages alsaciens catholiques, mais trouve son origine dans ces rites de protection des foyers. Le Braucher pouvait aussi préparer des petits sachets talismaniques contenant des herbes consacrées (verveine, millepertuis), des médailles et une prière écrite, que l’on portait sur soi ou que l’on enfouissait dans les fondations de la grange. Le but était de “blinder” en quelque sorte l’espace vital contre les influences néfastes – qu’elles proviennent d’un voisin jaloux, d’un esprit malfaisant ou du Diable lui-même.
En toutes ces pratiques bienfaisantes de Braucherei, l’idée directrice est la recherche de l’harmonie et de la santé par l’intermédiaire du sacré. Le Braucher se voit en intercesseur, un peu comme un prêtre officieux de la communauté, réconciliant l’homme et les forces qui le dépassent. Il rend accessibles les grâces divines pour des besoins concrets : guérir une brûlure, faire revenir les abeilles dans le rucher ou apaiser une dispute familiale. C’est pourquoi le peuple lui portait respect et gratitude. Toutefois, cette magie bénéfique n’existait que parce qu’en face, on redoutait son opposé maléfique : la Hexerei, la sorcellerie mauvaise qui jette des sorts. Si le guérisseur était indispensable, c’était aussi parce que la crainte des Hexen (sorcières) restait bien vivante.
La Hexerei, ou la crainte des maléfices et la contre-sorcellerie
En Alsace comme en Lorraine, le terme allemand Hexerei désigne la sorcellerie malveillante, celle qui vise à nuire en secret. Il s’agit typiquement de la magie noire attribuée aux Hexe (les sorcières ou sorciers maléfiques). Dans la mentalité villageoise d’autrefois, de nombreux malheurs inexplicables étaient imputés à ces œuvres occultes : maladies soudaines du bétail, orages dévastateurs, enfant qui dépérit sans cause apparente, beurre qui ne prend plus à la baratte. On vivait dans la hantise de ce mal invisible qu’était le sort, le maléfice. Ainsi, tout une réputation de la Hexerei s’était développée, avec ses personnages (la vieille sorcière jalouse, le rebouteux qui vend son âme) et ses récits d’ensorcellements.
Les accusations de sorcellerie ont fait des ravages dans l’histoire de la région. À la fin du Moyen Âge et surtout à l’époque moderne (16ème-17ème siècles), Alsace et Lorraine furent le théâtre d’une intense chasse aux sorcières, alimentée par la peur du Diable. Des centaines de personnes – en majorité des femmes – furent jugées et exécutées pour Hexerei, sur la base de simples soupçons ou de malédictions rapportées. Cette répression féroce, instruite par les tribunaux civils ou religieux, a laissé une empreinte durable dans la mémoire collective. Même après la fin des grands procès, la figure de la sorcière est restée un épouvantail dans les campagnes. On évitait la compagnie de telle vieille femme réputée “avoir le mauvais œil”, ou que tel rebouteux avait un grimoire diabolique pour pactiser avec Lucifer.
Les pouvoirs attribués aux sorcières étaient redoutables. On leur prêtait la capacité de nuire aux biens et aux êtres de multiples façons. En Lorraine on racontait que les sorcières pouvaient, la nuit de Walpurgis ou à d’autres moments propices, voler la fertilité d’un champ en récoltant la rosée avec un drap, ou détourner le lait des vaches en installant un manche à balai dans l’étable et en le “traignant” comme une vache imaginaire. Elles pouvaient jeter un sort sur le blé pour qu’il ne lève pas, mettre des vers dans la farine du moulin, ou encore empêcher une jeune mariée de consommer son mariage en cachant sous son lit une aiguille ayant servi à coudre un linceul. Les récits abondent : untel a trouvé un matin un crapaud noir dans l’auge de ses porcs – signe certain qu’une sorcière avait jeté un sort aux bêtes ; tel autre a vu ses vaches tomber malades l’une après l’autre, sans doute parce qu’une Hexe avait enterré sous l’étable un sachet maudit contenant des os de crapaud et des herbes du sabbat. Même des phénomènes naturels comme une invasion soudaine de chenilles pouvaient être attribués à la malice sorcière.

Des Hexerei arrivant au sabbat. Source
Face à cette peur omniprésente du maléfice, la société rurale a développé des moyens de défense et de contre-sorcellerie – c’est là que la Braucherei rejoint la lutte contre la Hexerei. Le Braucher était celui vers qui l’on se tournait en cas de soupçon de sortilège. Son rôle n’était pas seulement de guérir, mais aussi de défaire le mal causé par un sorcier. On l’appelait par exemple pour “lever” un sort qui pesait sur un malade : il employait alors des prières d’exorcisme ou de délivrance, parfois en latin (comme le célèbre Exorcisme contre Satan et les anges rebelles, ou des prières spéciales contre les esprits nuisibles). Il pouvait aussi conseiller des gestes apotropaïques à la victime : mettre du sel bénit aux quatre coins de la maison, porter sur soi une “prière contre les sorciers” écrite en latin sur un parchemin, ou encore clouer une branche d’aubépine (plante de protection) au-dessus de la porte.
Dans bien des cas, le simple fait de déclarer le sort “rompu” par l’entremise du guérisseur redonnait confiance à la personne envoûtée – et cette confiance participait de la guérison. L’efficacité de la contre-sorcellerie relevait autant de la psychologie que du sacré : dès lors que la victime n’avait plus peur, le pouvoir de la sorcière s’évanouissait. Par ailleurs, le Braucher pouvait tenter d’identifier le sorcier responsable en recourant à des procédés traditionnels. Une méthode consistait à faire fondre du plomb ou de la cire dans une bassine d’eau en récitant une incantation, puis à observer les formes figées : on pouvait y voir l’initiale ou la silhouette de la personne maléfique. D’autres fois, on allumait trois cierges au nom de la Trinité et on prononçait : « Que l’ensorceleur qui a fait ce mal se présente à cette maison » – et si quelqu’un de suspect arrivait bientôt, on le tenait pour le coupable.
Il est intéressant de noter que la frontière entre Braucher et Hexer était parfois floue. Officiellement, le Braucher se défendait d’user de Hexerei : il se voyait comme l’antidote du sorcier, non son complice. Il soignait là où l’autre avait voulu nuire. Dans la langue pennsylvanienne issue de nos dialectes, on dit bien : « Braucherei » pour la magie bénéfique et « Hexerei » pour la maléfique, et les deux sont en principe opposées. Le braucher (aussi appelé Powwow doctor en anglais) est appelé pour retirer un sort jeté par un hexer. Néanmoins, aux yeux de certains, tous manipulaient des forces occultes et la limite pouvait être ténue : un guérisseur réputé pouvait aisément être accusé de sorcellerie s’il suscitait l’envie ou la crainte. La différence tenait souvent à la moralité prêtée à la personne. Tant qu’il oeuvrait pour le bien et rendait grâce à Dieu, c’était un bon sorcier acceptable ; s’il commençait à proférer des malédictions ou à faire payer trop cher ses services, on le soupçonnait de pactiser avec le Malin. Cette ambiguïté a suivi la figure du sorcier-guérisseur jusqu’à l’époque contemporaine : on admire son savoir, mais on s’en méfie toujours un peu.
Le Himmelsbrief, la lettre du Ciel protectrice
Parmi toutes les pratiques magico-religieuses de la région, le Himmelsbrief occupe une place à part. Ce terme allemand signifie littéralement « lettre du Ciel ». Il désigne un document écrit, présenté comme d’origine divine – on dit qu’il a été rédigé par Dieu lui-même, par le Christ ou un ange – et qui promet protection et bénédictions à celui qui le possède. Le concept du Himmelsbrief est ancien et ne se limite pas à l’Alsace-Lorraine : on en trouve trace dès le Moyen Âge, avec la légende d’une lettre de Jésus tombée du ciel pour exhorter les hommes à la piété et les protéger des fléaux. Au 13ème siècle, le chroniqueur Joinville rapporte qu’un certain Jacob, chef de la croisade des pastoureaux (1251), brandissait une lettre prétendument donnée par la Vierge Marie pour galvaniser les foules. Ce motif de la lettre céleste réapparaît périodiquement dans l’histoire européenne, aussi bien en milieu orthodoxe, catholique que protestant : chaque fois, il s’agit d’un message sacré descendu miraculeusement, porteur de promesses de salut mais aussi de conditions strictes (souvent, l’ordre de recopier la lettre et de la diffuser, sous peine de châtiment divin).

Himmelsbriefs. Source
En Alsace et en Lorraine, le Himmelsbrief s’est diffusé surtout à l’époque moderne et contemporaine, en lien avec l’imprimerie populaire et la dévotion domestique. Ces lettres du bon Dieu se présentaient sous forme de broadsides (placards imprimés) ou de manuscrits que l’on conservait pieusement à la maison. On les accrochait parfois au mur, dans la pièce principale ou dans l’étable, comme une sorte d’aumônière spirituelle protégeant le foyer et le bétail. D’autres les portaient sur eux, pliées dans une petite poche de cuir, surtout lorsqu’ils devaient s’absenter en voyage ou à la guerre. Le contenu typique d’un Himmelsbrief mélange des versets bibliques, des prières (comme le Notre Père, des extraits de psaumes) et des formules d’assurance divine. La lettre proclame que « tout porteur de ce message sera gardé de la mort subite, des balles, de la foudre, de la peste,… », énumérant une liste de périls terrestres dont on sera protégé. En revanche, elle avertit que celui qui la méprise ou ne la reproduit pas fidèlement s’attirera des malheurs – car il y a un prix à payer pour la protection divine. La plupart de ces lettres se terminent ainsi par une injonction : « Copiez cette lettre et faites-en profiter vos semblables » – ce qui en a fait de véritables chaînes spirituelles à travers les générations.
Le Himmelsbrief a connu un succès tout particulier durant les périodes troublées, où la protection divine était ardemment recherchée. Notamment, lors de la Première Guerre mondiale (1914-18), de nombreux soldats allemands – y compris les Alsaciens-Mosellans incorporés de force dans l’armée du Kaiser – emportaient avec eux au front des lettres de protection. Des mères ou des épouses recopiaient à la main une formule de Himmelsbrief pour leur fils ou mari partant à la guerre, pour que ce talisman les rendrait invulnérables aux balles. Un cas documenté est celui de Marie Geffers, une fermière de Basse-Saxe, qui en août 1914 rédigea de sa plus belle écriture une lettre magique à l’attention de son gendre Richard, partant au combat. Sur un formulaire de courrier de campagne (Feldpostbrief) elle coucha des passages bibliques, des invocations de la Trinité et diverses assurances de protection contre les armes – des textes qu’elle avait probablement copiés à partir de modèles circulant parmi ses voisines. Ce Himmelsbrief de tranchée, comme tant d’autres, préservera le soldat du danger, à condition qu’il le garde pieusement sur lui et demeure en état de grâce. La pratique était si répandue que les autorités militaires s’en inquiétèrent parfois, y voyant une superstition pouvant confiner à l’insubordination (un soldat qui se croit invincible pourrait prendre des risques inconsidérés). Mais pour ces hommes confrontés quotidiennement à la mort, tenir dans leur poche une lettre manuscrite de leur mère mêlant prière et magie devait apporter un réel réconfort psychologique – et bien sûr une protection tangible aux yeux de la foi.
Le contenu des Himmelsbriefe varie, mais certains éléments reviennent. Outre les prières et les bénédictions, on y trouve des symboles sacrés dessinés ou calligraphiés : le nom de Jésus en lettres ornementées, des croix, le monogramme IHS, les trois clous de la Crucifixion. Parfois, la lettre prend la forme d’un dialogue céleste (Jésus dicte la lettre à un ange). D’autres incluent des consignes morales très précises : assistance aux pauvres, observation du dimanche,... faisant du texte un rappel des devoirs du bon chrétien autant qu’un fétiche. Cette double nature est intéressante : le Himmelsbrief offre une protection “automatique” par sa seule présence, mais il exhorte également son possesseur à mener une vie vertueuse, condition implicite de l’aide divine. En ce sens, on pourrait dire qu’il s’agit d’une alliance : Dieu protège l’individu via la lettre, et en échange l’individu s’engage à la foi et à la droiture.
Dans nos régions alsaciennes et lorraines, on obtenait un Himmelsbrief soit en le faisant écrire par un praticien respecté (un Hexenmeister ou Braucher renommé), soit en achetant une version imprimée lors d’un pèlerinage ou d’une foire religieuse. En effet, dès le 18ème siècle, des colporteurs vendaient des imprimés de bénédictions et de lettres célestes à bon marché. Cependant, beaucoup de gens préféraient la version manuscrite, jugée plus authentique et puissante, surtout si elle provenait de la main d’un guérisseur connu pour sa foi. Certains Hexenmeister monnayèrent ainsi leurs talents d’écriture mystique, écrivant des Himmelsbriefe personnalisés en échange d’une somme parfois coquette. D’autres, au contraire, considéraient que ce savoir ne devait pas être vendu : le vrai Himmelsbrief, selon eux, devait être donné gratuitement ou moyennant un don symbolique, sans quoi il perdrait sa vertu. Dans tous les cas, ces lettres magiques circulaient abondamment. Encore au début du 20ème siècle, on en trouve accrochés dans les maisons de paysans en Moselle ou en Alsace, aux côtés des crucifix et des images pieuses, témoignant de la popularité tenace de ces talismans religieux.
On peut voir dans le Himmelsbrief l’aboutissement de cette fusion entre magie et foi qui caractérise la sorcellerie alsacienne-lorraine. Ce n’est rien de moins qu’un sacramental issu du peuple : un objet de papier portant la Parole divine et servant de protection quasi-sacramentelle. Ni tout à fait approuvé par l’Église (qui a souvent cherché à supprimer ces “écrits superstitieux”), ni entièrement étranger à la piété chrétienne (puisque saturé de textes bibliques et de prières), le Himmelsbrief navigue entre orthodoxie et magie. Il incarne le souhait humain d’avoir un contrat tangible avec le Ciel : quelques lignes écrites et l’espoir que Dieu signera en bas de page pour exaucer Sa promesse de garder Ses enfants des dangers.
Persistance et héritage
Les pratiques magiques alsaciennes et germano-lorraines constituent un héritage culturel riche. Bien sûr, le contexte a radicalement changé : le monde rural traditionnel a en grande partie disparu, emportant avec lui une partie de ces croyances actives. À l’ère de la médecine scientifique et de la technologie, rares sont ceux qui consultent un leveur de sorts pour guérir le bétail ou qui glissent une lettre céleste sous l’oreiller pour éloigner la foudre.
Dans les campagnes d’Alsace et de Lorraine (ainsi que dans d’autres régions de France), on trouve encore des personnes que l’on appelle guérisseurs ou détenteurs du secret. Ces héritiers de la Braucherei continuent de soigner les brûlures, le zona, les verrues ou le “feu sauvage” exactement comme le faisaient leurs ancêtres. Ces pratiques bénéficient d’une tolérance sociale – y compris de la part de certains médecins qui constatent, pragmatiques, l’amélioration de leurs patients combinant les deux approches. On est bien loin des persécutions d’antan : le guérisseur d’aujourd’hui n’est plus pourchassé comme sorcier. Mais au-delà, il y a une leçon à retenir : nos aïeux, sans diplômes ni technologie, avaient développé un savoir de l’âme et du cœur pour alléger les souffrances et apprivoiser la peur.
Sources :
-
Kriebel, David W. Powwowing Among the Pennsylvania Dutch: A Traditional Medical Practice in the Modern World. University Park, PA: Penn State University Press, 2007.
-
Donmoyer, Patrick J. Powwowing in Pennsylvania: Braucherei & the Ritual of Everyday Life. Kutztown, PA: Pennsylvania German Cultural Heritage Center, 2017 (catalogue d’exposition et étude avec sources primaires).
-
Yoder, Don. « Hohman and Romanus: Origins and Diffusion of the Pennsylvania German Powwow Manual », in American Folk Medicine: A Symposium, University of California Press, 1976, p. 235-248.
-
Hohman, John George. The Long Lost Friend [1820] (éd. anglaise 1850, texte numérisé). Source primaire majeure de la Braucherei.
-
Bächtold-Stäubli, Hanns & Hoffmann-Krayer, Eduard (dir.). Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens (HDA). Berlin–New York: de Gruyter, 1927-1942 (réimpr. 1987). Voir entrées « Himmelsbrief » (R. Stübe) et « C.M.B. » sur la bénédiction d’Épiphanie.
-
Stübe, Rudolf. « Himmelsbriefe und Kettengebete », Wissenschaftliches Jahrbuch des Tiroler Landesmuseums, 6 (2013), p. 245-255 (synthèse historico-comparative).
-
Briggs, Robin. The Witches of Lorraine. Oxford: Oxford University Press, 2007, et base documentaire associée (env. 400 dossiers de procès).
-
Follain, Antoine & Simon, Maryse (dir.). La sorcellerie et la ville. Strasbourg: Presses universitaires de Strasbourg, 2018 (notamment le chapitre de A. Follain sur la Lorraine urbaine et rurale).
-
Simon, Maryse. Les affaires de sorcellerie dans le val de Lièpvre (XVIe–XVIIe siècles). Strasbourg: Publications de la Société Savante d’Alsace, 2006 (compte rendu dans Revue d’Alsace, 2007).
-
Diedler, Jean-Claude. « Un procès de sorcellerie en Lorraine du Sud au début du XVIIe siècle », Histoire & Sociétés Rurales, n° 7, 1997, p. 133-172 (édition critique de sources judiciaires).
-
Rémy, Nicolas. Daemonolatreiae libri tres, 1595 (trad. angl. Demonolatry, 1929). Traité démonologique lorrain fondé sur un vaste corpus de procès.
-
Roehrig, Jacques. Procès de sorcellerie aux XVIe–XVIIe siècles dans les terres de l’Est: Alsace, Franche-Comté, Lorraine. 2016 (notice BNU Strasbourg).
-
Archives de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg. « Procès en sorcellerie au Ban de la Roche » (présentation de documents d’archives, contexte alsacien).
-
Wikisource (DE). « Himmelsbrief von 1864 » (exemple de lettre céleste du XIXe siècle, source primaire).
-
Glencairn Museum. « Powwowing in Pennsylvania: Healing Rituals of the Dutch Country », Newsletter, 9 mars 2017 (transcription de manuscrits sur le transfert d’un mal dans un arbre).
-
Musées de Strasbourg – Musée Alsacien. Dossier de presse (2024) et ressources sur l’imagerie dévotionnelle et les objets domestiques alsaciens (pertinent pour les Haussegen et protections de foyer).