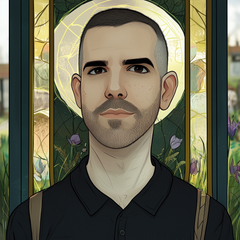Au fond des Pyrénées, un filet d’eau traverse la roche et coule sans relâche depuis plus de 150 ans au pied de la grotte de Massabielle. Des millions de personnes ont bu cette eau, l’ont touchée, versée dans leurs paumes, parfois avec espoir, parfois avec ferveur. L’eau de Lourdes n’a ni couleur particulière, ni goût remarquable. Elle ne provient pas d’un sommet isolé ni d’un sol volcanique rare. Pourtant, elle occupe une place à part, celle d'une eau miraculeuse.
1. Un filet d’eau, une histoire qui déferle
Lourdes, au milieu du 19ème siècle, n’est encore qu’un bourg modeste du piémont pyrénéen. La grotte de Massabielle, aux abords de la commune, passe inaperçue. Elle n’a ni réputation particulière, ni fonction précise. L’endroit est considéré comme une zone sauvage, comme on en voit partout ailleurs. Rien ne la distingue des dizaines d’autres cavités naturelles disséminées dans la région.
La situation du village reflète celle de nombreuses communes rurales françaises de cette époque. L’eau potable ne coule pas encore dans tous les foyers, l’hygiène reste rudimentaire, les maladies frappent régulièrement. Sur le plan spirituel, la région est très marquée par le catholicisme, mais la pratique religieuse varie d’une vallée à l’autre. À cette époque, l’Église cherche à affermir sa présence face aux idées nouvelles qui circulent, notamment dans les villes.

Grotte de Massabielle. Source : Lourdes France
Rien ne laissait prévoir que cette grotte deviendrait l’un des lieux religieux les plus visités au monde. Et pourtant, en février 1858, tout bascule. Une jeune fille de 14 ans, Bernadette Soubirous, issue d’un milieu modeste, raconte avoir vu une “dame” dans la grotte. Ce qu’elle dit provoque l’incrédulité, puis la curiosité. Elle revient, affirme voir à nouveau cette même figure. La population locale commence à s’intéresser à ces événements. L’Église, prudente, surveille sans se prononcer.
Ce n’est que quelques semaines plus tard que Bernadette gratte le sol de la grotte sur indication de cette “dame”, et qu’un filet d’eau se met à suinter. Ce geste marque le point de départ d’une histoire qui ne cessera plus de grandir.
2. L’affaire Bernadette Soubirous
Le 11 février 1858, Bernadette Soubirous se rend à la grotte de Massabielle avec sa sœur et une amie. En ramassant du bois, elle aperçoit une silhouette lumineuse dans une niche de la roche. Elle parle d’une “jeune fille”, vêtue de blanc, ceinte d’une ceinture bleue, les pieds nus. Elle garde cette vision pour elle, puis finit par en parler. Très vite, l’annonce circule à travers la commune. Le curé, les autorités locales et les notables réagissent avec réserve. L’évêque de Tarbes se tient à distance.

Apparition mariale à Lourde. Source : Wikipédia
Au fil des jours, Bernadette retourne à la grotte. Elle affirme revoir la même personne. La foule commence à affluer. L’enfant, jugée sincère mais peu instruite, ne modifie pas son récit. À la neuvième apparition, celle du 25 février, Bernadette creuse dans le sol à un endroit précis, sur indication de l’apparition. Une eau boueuse jaillit. Elle s’écoule d’abord en mince filet, puis en débit plus régulier. Cette source devient rapidement le point de convergence de ceux qui espèrent une grâce ou une amélioration de leur état.
La “dame” parle peu. Elle demande la prière, la pénitence, et finit par dire : « Je suis l’Immaculée Conception. » Cette formule, à peine connue de la population locale, a été définie comme dogme catholique quelques années plus tôt, en 1854. Ce détail pousse l’évêque de Tarbes à accorder du crédit au témoignage. Une commission est formée. En 1862, l’Église reconnaît officiellement les apparitions comme authentiques.
À ce moment-là, la source continue de couler. Elle ne tarit pas. Aucun canal artificiel ne l’alimente. Des fidèles commencent à l’utiliser, à s’y baigner, à la rapporter chez eux. La grotte devient un lieu de rassemblement religieux. L’eau devient le support matériel d’un événement qui dépasse Lourdes.
3. L’eau coule, les foules accourent
Dès les premiers mois qui suivent la reconnaissance officielle des apparitions, Lourdes change d’échelle. Le village se transforme radicalement. Des routes sont élargies, des hôtels apparaissent, les premiers pèlerinages s’organisent. L’eau issue de la source devient un élément central du lieu. On vient pour la grotte, mais on repart avec de l’eau. Elle passe entre les mains, dans les mouchoirs, sur les visages. On y plonge des enfants malades, on l’administre aux mourants. Les premières guérisons sont rapportées de manière orale, puis consignées.
Pour faire face à l’affluence, les autorités religieuses mettent en place une organisation structurée. Un circuit est installé pour canaliser les pèlerins. Des robinets sont fixés, des bassins sont construits pour permettre les bains. La source est protégée. L’eau est analysée. Aucun agent pathogène ne ressort des premières études. On commence à embouteiller l’eau dans des fioles en verre, puis plus tard dans des contenants en plastique. La diffusion prend de l’ampleur.
En 1883, un médecin protestant, le Dr Georges-Fernand Dunot de Saint-Maclou, propose la création d’un bureau chargé d’examiner les guérisons. Il veut écarter les cas douteux et ne retenir que ceux qui résistent à l’analyse. Le Bureau des Constatations Médicales est fondé. Il s’appuie sur des critères stricts : absence de traitement médical au moment de la guérison, rétablissement complet, diagnostic initial certain, caractère instantané et durable.

Bureau des Constatations Médicale. Source : Actu
Cette exigence n’empêche pas la fréquentation du sanctuaire de grimper. Chaque année, des trains entiers débarquent à Lourdes. Des malades arrivent sur des brancards, parfois portés par des bénévoles. On baigne les corps dans les piscines. On recueille l’eau pour la ramener au pays. Certaines bouteilles restent des années dans les placards, d’autres sont utilisées le jour même. Ce geste devient un rite, répété à travers les générations.
En février 2024, le 72ème miracle officiel est reconnu par l’Église catholique. Une femme de 50 ans, atteinte d’une pathologie invalidante, déclare avoir été guérie à la suite de son passage aux piscines. L’enquête médicale a duré plusieurs années. Ce cas vient s’ajouter à une liste très restreinte au regard des millions de visiteurs. L’Église continue de parler de miracles, mais toujours après des expertises longues et rigoureuses.
4. Une eau comme les autres ? Pas tout à fait
L’eau de Lourdes n’a rien d’exceptionnel sur le plan scientifique. Elle ne contient ni élément radioactif, ni trace de minéral rare, ni bactérie exotique. Les analyses chimiques la décrivent comme une eau de source ordinaire, faiblement minéralisée, de type calcique et magnésienne. Elle provient d’une nappe souterraine, captée naturellement à la grotte, et renouvelée en permanence. Sa température, constante autour de 12°C, n’a jamais varié de manière significative.
Ces caractéristiques ne permettent pas d’expliquer les guérisons signalées à Lourdes. Aucune propriété médicale n’a été détectée. Les autorités religieuses elles-mêmes refusent de parler d’une eau miraculeuse en soi. Le miracle, s’il y en a un, ne se situerait pas dans la composition, mais dans ce qui entoure l’usage de l’eau : intention, prière, contexte, foi ou espérance. Le Bureau Médical ne se prononce jamais sur les causes. Il établit seulement les faits : maladie avérée, disparition complète, absence de traitement médicamenteux suffisant pour justifier une telle évolution.

Les piscines du sanctuaire. Source : Office du Tourisme de Lourdes
Et pourtant, cette eau continue à tenir une place particulière dans l’imaginaire collectif. Elle n’est pas vendue, mais distribuée librement (seul les porteurs et contenants composent le prix). Le sanctuaire rappelle régulièrement qu’elle ne peut pas se substituer à un traitement. Cela n’empêche pas son utilisation dans des contextes très variés : douleurs chroniques, troubles psychiques, fatigue, blocages affectifs, ou situations désespérées.
Elle devient aussi un symbole. Elle incarne quelque chose qui dépasse l’objet matériel. Elle circule, traverse les frontières, franchit les océans. Cette eau peut n’avoir aucun effet mesurable, mais elle reste active dans les gestes, dans les attentes et dans les récits.
5. Des mains aux lèvres, de la grotte à la maison
L’eau de Lourdes n’est pas seulement utilisée sur place. Elle accompagne les pèlerins bien au-delà du sanctuaire. Très tôt, des systèmes de distribution sont mis en place. Des robinets sont fixés en bordure de la grotte, des bouteilles en plastique apparaissent, moulées en forme de la Vierge, parfois simplement neutres. On peut remplir soi-même ses contenants, ou recevoir des fioles déjà prêtes dans les lieux d’accueil du sanctuaire. Chaque année, plusieurs millions de litres sont ainsi prélevés à la source, sans interruption.
Une fois ramenée à domicile, l’eau s’installe dans des habitudes. Certains l’appliquent sur le front ou les poignets, d’autres l’ajoutent à l’eau du bain, d’autres encore la boivent goutte à goutte comme un élixir. Elle se mêle à des pratiques de bénédiction dans les foyers, au baptême d’un nouveau-né, ou à un simple geste avant de dormir. L’eau devient parfois un objet de transmission. Elle passe d’une génération à l’autre, enfermée dans un flacon rangé avec soin. Elle n’a pas besoin d’être utilisée tout de suite. Elle attend.
Son usage s’étend aussi à des espaces plus personnels : tiroirs, petits autels, boîtes à bijoux, portefeuilles. Des fioles sont glissées dans des bagages avant une opération ou un départ important. D’autres sont conservées à côté d’une photo, d’une médaille, ou d’une lettre. Dans certains cas, elle entre dans des rituels très codifiés. Elle est versée dans les fondations d’une maison, frottée sur des objets, mêlée à de l’encens ou à d’autres ingrédients sacrés.
Malgré sa forte connotation catholique, cette eau est utilisée par des personnes qui ne se définissent pas comme pratiquantes. Son lien au religieux ne fait aucun doute. Elle provient d’un lieu reconnu par l’Église, elle est liée à une apparition mariale, elle est bénie dans certains cas. Mais ce cadre n’empêche pas l’apparition de lectures différentes. Certaines personnes perçoivent dans cette eau la trace d’une force, sans vouloir la nommer. D’autres évoquent la possibilité d’un esprit protecteur, sans le relier nécessairement à la tradition chrétienne. L’ange, la Vierge, une entité naturelle, un esprit ancien : les interprétations varient, et laissent volontairement une part de flou.
6. La médecine face à l’inexplicable
Lourdes reste, aujourd’hui encore, l’un des seuls lieux religieux au monde à disposer d’une structure médicale indépendante chargée d’examiner les guérisons rapportées.
Depuis sa création, le Bureau des Constatations Médicales a reçu plus de 7 000 déclarations de guérison. Mais seule une infime partie a franchi toutes les étapes. En 2024, un 72ème miracle a été reconnu officiellement. Une femme souffrant d’une maladie invalidante aurait connu une amélioration spectaculaire et durable à la suite d’un bain dans les piscines du sanctuaire. L’étude de son dossier médical, croisée avec des expertises indépendantes, a permis à l’Église de valider ce cas selon ses critères internes.
La dimension religieuse n’intervient qu’à la toute fin du processus, lorsque l’évêque de la personne concernée choisit ou non de reconnaître officiellement un miracle.
Cette prudence contribue à maintenir un équilibre délicat entre science et foi. Les guérisons inexpliquées restent rares, mais elles existent. Elles suscitent l’intérêt de certains chercheurs, la prudence d’autres, et le silence de beaucoup. Pour les personnes concernées, il ne s’agit pas toujours de chercher une explication. Il s’agit de témoigner d’un fait : quelque chose s’est produit, sans explication satisfaisante.
7. Lourdes et les miracles
La majorité de ces guérisons concernent des affections graves : tuberculose osseuse ou pulmonaire, tumeurs, paralysies, sclérose en plaques, maladies chroniques évolutives. Beaucoup de miraculés ont été déclarés incurables par plusieurs spécialistes, hospitalisés ou fortement diminués au moment de leur venue à Lourdes. Certaines guérisons ont eu lieu en quelques secondes, d’autres dans les jours suivant le retour à domicile. Plusieurs se sont produites au moment de l’immersion dans les piscines, d’autres lors d’une bénédiction, d’une prière ou d’un simple geste avec l’eau de la source.
Les cas reconnus se répartissent entre la fin du 19ème siècle et le début du 21ème. Les premières guérisons datent des années 1860-1880. Le rythme s’est ralenti au fil des décennies, notamment à partir des années 1970. Les dernières reconnaissances sont espacées, mais toujours possibles. Les personnes concernées sont le plus souvent des femmes, de tous âges, venues de France, d’Italie, de Belgique ou d’autres pays d’Europe. Certains enfants figurent aussi parmi les miraculés.

Basilique de l'Immaculée-Conception de Lourdes. Sources : Wikipédia
Le processus de validation repose sur plusieurs étapes. Une guérison est d’abord déclarée par la personne ou son entourage. Un dossier médical complet est constitué. Des spécialistes étudient les diagnostics initiaux, les traitements reçus, les examens de suivi. Si la guérison paraît inexplicable, le Bureau Médical transmet le cas au Comité Médical International de Lourdes. Ce dernier décide s’il s’agit d’un fait “médicalement inexpliqué”. Enfin, l’Église peut, ou non, reconnaître un miracle selon ses propres critères spirituels.
Le 72ème miracle a été reconnu le 16 avril 2025. Antonietta Raco, une Italienne de 67 ans atteinte de sclérose latérale primitive, une pathologie neurodégénérative incurable, a connu une guérison soudaine après avoir été immergée dans les piscines de Lourdes en 2009. Elle a retrouvé l’usage de ses jambes, sans rechute depuis. Son cas a fait l’objet de quinze années d’étude avant d’être validé par le comité médical et par l’évêque de son diocèse. Il s’agit de la première reconnaissance officielle depuis plusieurs années.
8. Miracle économique
En 2024, le Sanctuaire de Lourdes a accueilli environ 3,1 millions de visiteurs, un chiffre stable par rapport à 2023. Parmi eux, 400 000 ont participé à des pèlerinages organisés, tandis que le reste des visiteurs est venu individuellement ou en petits groupes.

Pèlerinage à Lourdes
La ville de Lourdes, avec une population d'environ 13 800 habitants, voit sa population multipliée pendant la saison des pèlerinages. Elle dispose de plus de 23 000 lits touristiques, dont environ 85% sont des lits hôteliers, faisant d'elle la deuxième ville hôtelière de France après Paris !
L'économie locale est évidemment fortement dépendante du tourisme religieux. En 2020, la pandémie de COVID-19 a entraîné une baisse de 90 % de l'activité touristique, mettant en évidence la vulnérabilité économique de la ville face aux fluctuations de la fréquentation.
Lourdes est ouverte aux visiteurs toute l'année, mais l'activité du sanctuaire connaît une saisonnalité marquée. La période principale des pèlerinages s'étend de Pâques à fin octobre. Durant ces mois, le sanctuaire accueille un grand nombre de pèlerins, avec des temps forts tels que le pèlerinage national de l'Assomption en août et le pèlerinage du Rosaire en octobre.
L'eau de Lourdes apaise parfois. Elle console, elle soutient, elle rappelle un moment ou une présence. C’est une eau qu’on ne regarde pas avec les yeux, mais avec le souvenir. Elle est venue d’un lieu, passée entre des mains, portée dans des prières. Et même si l’on ne sait pas ce qu’elle contient vraiment — ange, énergie, vieille force oubliée —, elle garde quelque chose de vivant qu'il ne faut peut-être pas chercher à expliquer.